· Qui sommes-nous ?
· GROUPES / REGIONS
Derniers groupes mis à jour :
· Pays Yonnais- Dialogue pour la paix
· Tibhirine - Nantes
· Asso Ephata Quimper
· CERDI
· Compostelle-Cordoue
· Croyants dans la Cité
· Cal. mois précedents 2024
· Calendrier interr. 2023
· Liens vers les amis
· En savoir plus sur les religions
Marche en Ariège 13 au 20 juillet 2024 : Randonnée dans la Réserve nationale de biodiversité d’Orlu, les monts d’Olme, le Pic St Barthélémy.
Strasbourg, du 14 au 20 octobre 2024 : Sacrées journées de Strasbourg - Festival des Musiques Sacrées du Monde.
MADIPAX, 3 au 10 mars 2024 : Voyage de la Paix interculturel à Barcelone.
Bulletin de Juin_2024 de l'association Tibhirine.
Bulletin de mai_2024 de l'association Tibhirine.
Bulletin de avril 2024 de l'association Tibhirine.
Bulletin de fevrier 2024 de l'association Tibhirine.
Bulletin de Janvier 2024 de l'association Tibhirine.
Bulletin de décembre 2023 de l'association Tibhirine.
Bulletin de novembre 2023 de l'association Tibhirine.
Bulletin d'octobre 2023 de l'association Tibhirine.
Bulletin de septembre 2023 de l'association Tibhirine.
Bulletin de janvier 2023 de l'association Tibhirine, voeux.
Bulletin de mai 2022 de l'association Tibhirine .(cliquer)
Bulletin d'octobre 2021 de l'association Tibhirine.(cliquer)>
le Bulletin d'avril 2021 de l'association Tibhirine.(cliquer)
le Bulletin de Decembre 2020 de l'association Tibhirine.(cliquer)
Nous vous recommandons des articles très intéressants à l'occasion du déconfinement dans:
Bulletin de juin 2020 de l'association Tibhirine.
La Lettre du CERDI, de juin 2020.
Et les numéros précédents, en temps de confinement:
Bulletin de mai 2020 de l'association Tibhirine.
l'Edition spéciale de la Lettre du CERDI ( Angers) sur le Coronavirus.
- Pour adhérer : Adhésion - Dispositif spécifique pour 2024 (cliquer )
- Pour nous contacter, participer à la vie de la CMRP,- Mode d'emploi du site :
Cliquer ICI
Refaire la France Replay dy débat aux Bernardins.
Sur l'Islam, débat entre Remi Brague et Ghaleb Bencheikh. Replay du débat aux Bernardins. Cliquer.
L'Islam et la liberté de conscience - Fondation de l'islam de France.
Si vous n'avez pas pu assister à ce Colloque en direct, il est visible en Replay sur la video de la Fondation de l'Islam de France ( cliquer )
Le Cri de la Paix, Religions et Cultures en dialogue, Rome 23 au 25 octobre 2022.
Avec Sant'Egidio. Autour de la guerre en Ukraine.
Video de l'Assemblée inaugurale, le 23 octobre 2022"
Frère Alois de Taizé : La prière comme source de paix. Cliquer.
- Vidéo de l'hommage-prière interconvictionnelle pour les victimes de la pandémie par l'association Agir pour la Fraternité.Paris 15e (cliquer)
- Mardi 5 février 2021 : vidéo-conférence :Fondacio, La dimension spirituelle des enjeux actuels, regards croisés ; juif, catholique, musulmane"> Revoir la rencontre du 5 février.
Vidéo à revoir : Cultiver la paix avec Louis Massignon.

Editorial du Président
De l’islam et de la laïcité, par Ghaleb Bencheikh
17 septembre 2022
Selon la boutade désormais classique, monsieur islam n’existe pas. Aussi, ne serait-ce pas le regard de l’islam sur tel concept qui pourrait être analysé dans les lignes qui suivent. Ce sont toujours des hommes et des femmes ayant embrassé la religion islamique qui pensent et agissent. Ce fut le cas ainsi à travers l’histoire notamment dans l’obédience sunnite qui ne reconnaît pas une structure cléricale ni autorité centrale. Auquel cas, je ne pourrai donner que mon avis d’homme nourri par quelques réflexions très sommaires sur le principe de laïcité, sur la notion du blasphème et sur l’incompatibilité irréductible qui serait entre le fait islamique et la République laïque.
La laïcité est un acquis de la modernité intellectuelle et politique. C’est une conquête de l’esprit humain. En ce sens qu’on ne gouverne plus la Cité selon le désir politique de Dieu que seuls certains prétendent avoir pénétré. Ceux-là, dès lors qu’ils ont scruté la volonté divine, ils se croient autorisés de l’imposer à leurs semblables.
La laïcité n’est pas la religion de ceux qui n’ont pas de religion ni une doctrine qui vient concurrencer celles dont elle est censée réguler la coexistence. La laïcité sans être adjectivée est un principe juridique sans épaisseur idéologique. Ou à l’extrême rigueur, c’est un principe politique adossé à un corpus de valeurs et formulé dans un dispositif législatif sans densité doctrinale. Il est avant tout un principe de liberté. Il implique, dans la philosophie politique, la neutralité de l’Etat quant aux affaires religieuses.
Sur un autre plan, aussi étonnant que cela puisse être, il n’y a pas de notion de blasphème dans la tradition islamique. En revanche, il y a l’offense faite à Dieu et la profanation du sacré ainsi que la dérision de la religion. Ce n’est que lors de l’affaire malheureuse dite de la fatwa de Khomeiny lancée contre Salman Rushdie pour sa fiction littéraire « les versets sataniques » que le mot blasphème a été projeté dans l’univers théologique islamique. Nous avons connu cet été un soubresaut de cette affligeante affaire avec la tentative d’assassinat l’écrivain par un jeune shiite fanatisé, admirateur de l’autocrate Khomeiny. Toujours est-il que lorsqu’il y a télescopage entre blasphème et liberté d’expression, le curseur sera toujours du côté de la liberté jamais du côté de la censure. La seule façon civilisée d’exprimer son désarroi, à supposer qu’il faille le faire lorsqu’on est blessé, est le recours à l’arbitrage des tribunaux. C’est le prétoire qui canalise la colère. Et comme les juges disent le droit et appliquent la loi, on sera quasi systématiquement débouté. Et pour les fragiles d’esprit, il ne leur reste plus qu’à espérer la responsabilité éthique de celui qui exerce sa liberté dans un sursaut de fraternité afin de ne pas offenser « gratuitement » son semblable. Sinon, il y a la patience, la magnanimité et la maîtrise de soi au moment de l’exaspération et de de l’irritation. Mais, in fine, en quoi une spiritualité vivante vécue dans la sérénité et la paix puisse être atteinte par quelque œuvre artistique ou littéraire, laquelle œuvre ayant naturellement son droit de cité. La révélation coranique et l’enseignement prophétique recèlent à profusion des préceptes allant dans le sens de l’équanimité, de la longanimité et du pardon. Dans la civilisation islamique sur la tapisserie des siècles, des propos et des œuvres – jugés blasphématoires à l’aune du fondamentalisme régressif – prévalaient dans les empires.
Ainsi, reprenant en partie l’expression d’Aristide Briand, énoncerai-je cette phrase, peut-être alambiquée, à propos de la laïcité : « c’est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi et la loi prime toujours la foi ».
En outre, je pense qu’en dehors de la tradition juive qui avec la notion de dina di malkouta dina qui pourrait être rendue par « la loi du « royaume » est la loi », aucune religion au monde n’a renoncé au pouvoir temporel motu proprio tout comme aucune religion ne résistera au vent de la laïcité lorsque celle-ci est comprise, ingérée et théorisée par ses propres théologiens et philosophes. L’expérience chrétienne avec la production intellectuelle de penseurs de renom catholiques et protestants comme Karl Rahner, Carl Barth, Paul Tillich, Gustave Tills, Hans Urs Van Balthasar et d’autres est très riche. Elle peut être une voie à suivre dans le sillage du théologien musulman Ali Abderraziq qui, en 1925, a composé son ouvrage « l’islam et les fondements du pouvoir ». C’est un investissement intellectuel qui est requis de nos jours.
L’islamologie moderne se doit de sauver la tradition islamique du suicide de la pensée. Elle doit préserver les esprits de tout abrasement de la réflexion et de la négation de l’intelligence, par-delà l’appartenance confessionnelle. Le fondamentalisme islamiste confond les contingences humaines du message révélé avec l’essence divine de ce message. Les premières s’articulent dans l’histoire, la seconde est assurément atemporelle et métahistorique. Le magistère idéologique du wahabo-salafisme a fait beaucoup de dégâts. Il nous incombe de le contenir et de le dirimer. La riposte sécuritaire pour nécessaire et vitale qu’elle soit n’est pas suffisante. Les réponses éducatives et culturelles viennent préparer la jeunesse, notamment musulmane, à une citoyenneté de responsabilité ; une citoyenneté épanouie dans le cadre d’une politique de civilisation et non celle d’une piètre gestion des revendications identitaires particulières.
Il nous faut une production savante assainie des scories d’une construction humaine sacralisée par méconnaissance avec la dé-dogmatisation de l’histoire et la dépolitisation de la religion. Aussi une sociologie de l’espérance et une téléologie terrestre de la grandeur de l’homme permettront-elles assurément d’immuniser les jeunes générations de l’intolérance fanatique. Elles devront les prémunir du danger du radicalisme et de ses méfaits. Il est temps d’en finir avec les lectures rétrogrades attentatoires à la dignité humaine d’un corpus éculé et dépassé. Et nous pourrons renouer avec l’humanisme dans une quête solidaire du sens de l’avenir. Un avenir de paix et de fraternité pour tous les hommes.
La modernité est aussi un mode de reproduction politique et de gestion des affaires de la Cité, fondé sur la dimension institutionnelle de ses mécanismes de régulation. Sous la voûte commune de la laïcité, la coexistence des spiritualités et la cohabitation des « sacrés » supposent une modification du sens temporel de la légitimité. L’avenir « remplace » le passé et rationalise le jugement de l’action associée aux hommes. C’est la possibilité politique de changer les règles du jeu de la vie sociale par le droit avec le respect des options métaphysiques des citoyens tant que l’ordre public est préservé. La norme juridique doit être une émanation rationnelle des hommes s’appliquant aux hommes pour leur bien-être. Et pour être obéie, la loi n’aura pas besoin de se fonder sur un régime discursif de la vérité revendiqué exclusivement par les religieux. La séparation des deux ordres religieux et politique est une avancée considérable.
 Contribution de Foudil Benabadji, administrateur de la CMRP-France, sur le sujet de la Laïcité.
Contribution de Foudil Benabadji, administrateur de la CMRP-France, sur le sujet de la Laïcité.Vous pouvez aussi vous référer à son site web, qui propose une formation :
Education à la citoyenneté et étude des dérives.
LA LAÏCITE +++
La France et plus largement l’Europe ont été le terrain de guerres de religion du XVIe au XIXe siècle.
En 1517, la critique luthérienne amorce une remise en question de l’Église catholique et un conflit avec la papauté.
Cet évènement majeur débouchera sur la naissance d’une nouvelle branche du christianisme : le protestantisme.
Née de la Réforme, cette jeune religion devient l’objet d’une lutte avec les différentes institutions et figures politiques.
C’est l’Inquisition romaine qui se met en chasse contre les hérétiques ;
C’est le massacre des protestants qui fait couler le sang des Saint-Barthélemy ;
C’est aussi l’assassinat d’un roi, Henri IV, dans sa tentative de restaurer la paix entre les communautés religieuses.
C’est la rivalité des religions de plusieurs siècles : La Guerre de Trente Ans.
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (1789)
 Les enjeux de la laïcité aujourd’hui.
Les enjeux de la laïcité aujourd’hui.Par Nicole Vernet. Vice-présidente de Religions pour la Paix-France.
Les enjeux de la laïcité aujourd’hui
La promulgation, le 9 décembre 1905, de la Loi de séparation des Églises et de l'État, dans un contexte très conflictuel entre les cléricaux et les laïques a ouvert enfin un cadre pour l’expression des religions et les situent par rapport à l’État.
Même si de nos jours certains s’interrogent sur la pertinence de ces principes et sur la manière dont ils ont été mis en œuvre, il n’en demeure pas moins qu’ils sont essentiels.

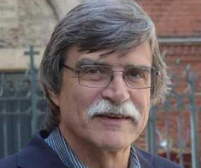 Nous avons appris avec une grande peine le décès de notre ami Frédéric Verspeeten, Pasteur de l'Eglise protestante unie de France. Nous avons particulièrement apprécié son intervention du 25/5/2021 : "Quelques pistes pour marcher vers un véritable dialogue interreligieux dans notre société laïque française". Nous assurons sa famille et sa communauté de nos profondes condoléances et de notre amitié.
Nous avons appris avec une grande peine le décès de notre ami Frédéric Verspeeten, Pasteur de l'Eglise protestante unie de France. Nous avons particulièrement apprécié son intervention du 25/5/2021 : "Quelques pistes pour marcher vers un véritable dialogue interreligieux dans notre société laïque française". Nous assurons sa famille et sa communauté de nos profondes condoléances et de notre amitié. Extrait de la Conférence du 25 mai 2021.
Extrait de la Conférence du 25 mai 2021.Enjeux du dialogue interreligieux dans une société sécularisée
par Ghaleb BENCHEIKH, président de la CMRP-France et de la Fondation de l'Islam de France
Propos recueillis d'un exposé non écrit.
Ghaleb dans un mot d’accueil, avant son exposé, se réjouit de la nouvelle dynamique de la Section française de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix (CMRP-France).
Une société sécularisée
Ghaleb rappelle les problématiques spécifiques et historiques de l’élément religieux en France par rapport aux autres pays. Les heurts vifs du passé entre le 19ème et le 20ème siècle, notamment autour de l’année 1905, sur les questions religieuses et la laïcité ont laissé des traces, même si progressivement survient l’apaisement entre la catholicité et l’anticléricalisme, grâce notamment aux interventions de théologiens catholiques et protestants de renom et au travail remarqué et remarquable.
Puis domine la sécularisation de la société française affichant des taux importants d’indifférence au fait religieux et à la pratique religieuse. Après mai 68 les termes de transcendance, de spiritualité et de solidarité se substituent aux mots Dieu, religion, charité.
Puis à la charnière du 20ème et du 21ème siècle, on assiste à un double mouvement de retour du religieux assez massif, voir revanchard, pour certains, avec certaines « dérives » du new-âge et du tout-spirituel avec le relativisme et le syncrétisme d’un côté, et du fondamentalisme, de l’extrémisme et du fanatisme jusqu’à l’idéologie djihadiste en passant par le conservatisme salafiste, de l’autre.
Bref, tous ces suffixes « ismes » étouffent les racines, particulièrement celles de la civilisation et de la tradition religieuse islamiques quand elles sont coupées de leurs véhicules culturels et de leur humanisme d’expression arabe.
Ces caractéristiques influent le dialogue interreligieux, dès ces périodes.
 Extrait de la Conférence du 25 mai 2021.
Extrait de la Conférence du 25 mai 2021.Quelques pistes pour marcher vers un véritable dialogue interreligieux dans notre
société laïque française
par le Pasteur Frédéric Verspeeten,
Église protestante unie de France
Rappels historiques
Depuis la révolution de 1789, par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la France a ouvert la voie à la liberté religieuse.
Par cette déclaration elle proclame en son article 10 que personne ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses sauf trouble à l’ordre public. La liberté de culte n’était pas gagnée pour autant !
En effet, ce principe a été contesté : d’une part par les ultras, qui souhaitaient le retour à la religion unique du roi de France et, à l’autre extrême, par la tentation de faire disparaître toute trace de manifestation d’un culte dans la société en promouvant le culte de la raison. Les cléricaux souhaitaient que la religion catholique retrouve une dimension institutionnelle, tandis que les anticléricaux allaient jusqu'à refuser toute religion.
 Gérard Leroy analyse dans son blog, "Questions en Partage", le laïcisme comme une dérive de la laïcité.
Gérard Leroy analyse dans son blog, "Questions en Partage", le laïcisme comme une dérive de la laïcité.Il permet ainsi une réflexion très utile dans une actualité brûlante.
Le laïcisme, dérive de la laïcité. ( cliquer ).
Vous pouvez envoyer des commentaires à religionspourlapaix.fr
 Lettre ouverte.
Lettre ouverte.Lettre à Monsieur Mohamed Boudjellaba, Maire de Givors,
De Gérard Leroy, membre de Religions pour la Paix.
C’est avec une indignation, non nouvelle, que j'ai parcouru le mot assassin adressé à vous, Monsieur Mohamed Boudjellaba, Maire de Givors dans le Rhône. Ce torchon révèle l’attardé signataire d’une haine que d’autres arriérés soutiennent, comme les tagueurs antisémites d’Oradour.
Il nous faut considérer avec lucidité et parfois colère la bêtise, et la dénoncer.
Des voyous ne voient d’issue que dans la violence. La régression barbare est le cancer qui gangrène notre société. Comment fraterniser les humains quand l’individu prisonnier de sa rancœur est rendu étranger à lui-même.
L’intolérable ne peut espérer de la tolérance. Surtout pas au nom de la liberté.
L'élément tragique pour l'homme moderne, c'est qu'il ignore la conduite morale agissante, comme service de la vérité, comme souci du prochain, souci essentiellement réglé par des critères humains.
La société est complexe parce qu’elle embrasse la diversité. La diversité exige la reconnaissance de la différence ; elle n’élimine pas les divergences ; la diversité est l’essence même de l’unité.
La sauvegarde de notre monde humain n'est nulle part ailleurs que dans le cœur humain, la pensée humaine, la responsabilité humaine. Tout cela ne va pas de soi.
Mais ce n’est pas le chemin qui est impossible, c’est l’impossible qui est le chemin. Sur ce chemin, Monsieur le Maire, je suis à vos côtés.
Gérard Leroy, ex-secrétaire général de la Conférence mondiale des religions pour la paix, section France.
 Voeux de Ghaleb Bencheikh, nouveau Président de la Fondation pour l’Islam de France, le 31 janvier dernier.
Voeux de Ghaleb Bencheikh, nouveau Président de la Fondation pour l’Islam de France, le 31 janvier dernier.Il a détaillé ses projets pour « un islam de beauté, d’intelligence et d’humanisme ».
Interview du journal La-Croix : La Fondation de l'Islam de France veut une grande cause nationale. (Cliquer )
Et dans Saphir News : Avec la FIF, Ghaleb Bencheikh plaide pour que plus jamais le vocable Islam ne soit synonyme d'épouvante. ( Cliquer )
 Les créationnistes ? -------------- par Foudil BENABADJI
Les créationnistes ? -------------- par Foudil BENABADJI Bonjour Monsieur Ruffier,
Dans le quotidien "Le Dauphiné Libéré", de dimanche 7 octobre, j'ai été agréablement surpris par votre coup de gueule : "La guerre aux créationnistes est déclarée". Parfois les médias interprètent magistralement nos pensées, et dans ce cas je voudrais réagir sur ce petit texte qui me paraît important du fait de l'actualité. "Il faut redonner le gout de la sciences et la place de la raison dans notre société". Nous savons tous ce qui se passe à Lyon, mais plus près encore, à Grenoble. Les gens savent-ils ce que sont les créationnistes ?
Le Conseil de l'Europe nous indique dans sa résolution du 04 oct. 2007, qu'actuellement les créationnistes, essentiellement d’obédience chrétienne ou musulmane, investissent de plus en plus dans l’enseignement. Il y a de quoi nous faire réfléchir. Le Collège de France est intervenu et a affirmé son opposition aux créationnistes. Ce courant est très fort, il a ses origines sur le continent nord-américain, et il existe actuellement chez nous, en France. Ces mouvements évangélistes et musulmans, en petites minorités certes, montrent un prosélytisme exacerbé. Ce qu'ils écrivent relèvent de la falsification. La montée en puissance de ce mouvement, l'endoctrinement des enfants et son impact sur notre société sont réels. Il s'agirait de mettre sous contrôle encore plus étroit le système d'éducation, et parallèlement inciter au rejet de la science, phénomène qu'ils exploitent cyniquement depuis un quart de siècle pour de petits profits politiques. Ce systéme de croyance est sans équivalent dans notre société ou plus du tiers de la population croit déjà que « les êtres vivants existent sous leur forme actuelle depuis le commencement des temps » et soutient l'idée d'interdire l'enseignement de la théorie de l'évolution pour la remplacer par le créationnisme.
Il est vrai que la culture générale, qui doit ouvrir à l’universel, c’est-à-dire à la connaissance de notre commune humanité dans ses différentes composantes, s’appauvrit considérablement lorsqu’elle se trouve amputée de la dimension religieuse. La prise en compte, chez nous en France, du Fait Religieux dans l’enseignement apporte des clés de lecture en ce domaine et réalise une ouverture des esprits par des rencontres constructives dans la découverte de l'histoire de la religion (ou encore : sciences des religions), et les richesses culturelles de l’autre. Mais des blocages, on ne sait d'où ils viennent, se manifestent aprement.
Face à la progression des fondamentalismes et des communautarismes, cet enseignement de type critique et rationnel représente un enjeu considérable. L’étude critique des textes, la prise en compte des genres littéraires, la critique historique des documents, permettent de prémunir les esprits à l’égard de la crédulité et des lectures simplistes.
La nécessité de cette prise en compte du Fait Religieux dans l’enseignement scolaire a été réaffirmée à plusieurs reprises depuis le rapport Debray. "Enseigner le Fait Religieux", cela renvoie à la dimension culturelle a indiqué Lionel Jospin en 1980. L’enseignement du fait religieux est nécessairement pluraliste puisqu'il traite des différentes religions - et non confessionnel : il aborde les religions en tant que faits de civilisation a déclaré Jack Lang en présentant ce rapport Debray. Alors, que font les politiques, qu'est-ce qu'on attend pour que les associations et les administrations reçoivent un grand coup de pousse et encourager les initiatives dans ce domaine précis.
En tant qu'aumônier dans les prisons de la Savoie, je considère que je suis dans un laboratoire. J'ai expérimenté le Fait Religieux. C'est un autre domaine dans lequel je peux apporter mon témoignage. (Il faudra aussi se prémunir de tous les discours, celui du fondamentaliste en particulier qui vous dira qu'il lutte contre la drogue et l'alcool, qu'il est un adepte de la laïcité et qu'il respecte les lois de la République .???..). Je voudrais aussi avoir l'occasion d'aborder le Niqab et la Burka qui se développent surtout parmi les converties..?..
Avec mes excuses d'avoir été trop long.
Foudil BENABADJI Aumônier musulman de la Pénitentiaire
Administrateur de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix.
Association UFCM / ICMF et UDEA 06 64 80 60 01
www.memoire-mediterranee.com.
 Organisée par la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix
Organisée par la Conférence Mondiale des Religions pour la PaixSoirée débat
"RELIGIONS ET DROITS DE L’HOMME "
Le 16 décembre 2009 à 20h00
Chapelle Saint Léon - 11 place du Cardinal Amette – 75015 PARIS
(Métro La Motte-Picquet – Grenelle)
Modérateur
Ghaleb BENCHEIKH – Président de la CMRP
Intervenants
Maurice RIEUTORD – s.j.
Mahmoud AZAB – Professeur à l’I.N.A.L.C.O.
Hervé élie BOKOBZA - Talmudiste et écrivain
Entrée libre

Le Père Higoumène BARSANUPHE, Vice-Président de
la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix propose ,
UN DIALOGUE OUVERT A TOUS
Sur le thème de
LES RELIGIONS POUR LA LAÏCITE
Hommage à PAPA IBRAHIMA SECK, récemment décédé.
Poète et politologue sénégalais
Projections et témoignage
16ème Rencontre Interreligieuse de Doumérac
le jeudi 6 août 2009 à partir de 14h
« Etre laïc, c’est avant tout reconnaître la liberté de l’esprit »
Papa Ibrahima SECK (1953-2009)
Au Centre de Rencontres Interreligieuses pour la Paix (CRIP)
Doumérac – 16380 GRASSAC 05 45 70 41 62 (rep.) / crip16@free.fr
 Information adressée par Norbert DUCROT - Administrateur de la CMRP
Information adressée par Norbert DUCROT - Administrateur de la CMRPLe Mouvement international de responsables chrétiens (Edmond Michelet)
et la paroisse Saint-Louis d'Antin
organisent une soirée-débat entre
le Père Christophe Roucou, délégué des évêques de France pour les relations avec l'Islam
et le Dr. Larbi Kechat, recteur de la mosquée Adda'wa,
sur le thème
"Quelle place pour les religions dans la société laïque française?".
Espace Bernanos - 4 rue du Havre - PARIS 9ème
le mardi 3 mars, de 18h. à 20h.
P.A.F. : 5 euros.

Colloque Hommage:
Unité sociale et unicité divine : La place de l’engagement social dans la spiritualité musulmane
Dimanche 11 Janvier 2009
13H - 17H
Institut international de la pensée islamique (IIIT France)
9-11, avenue Michelet 93400 Saint Ouen
Avec la participation de :
Ahmed JABALLAH, Tahar MAHDI, Yacob MAHI
Dhaou MESKINE, Mohamed MESTIRI, Tareq OUBROU
Présentation:
A l’heure d’une mondialisation essoufflée par une crise profonde de tous ordres - économique, sociale, politique, environnementale - une lueur d’espoir apparaît à nombre de gens comme une ressource intarissable. Face à ce malaise de l’être moderne, l’homme retourne à sa source, à son sens d’existence, à sa spiritualité afin de retrouver son équilibre en société.
Ainsi, l’Institut international de la pensée islamique - IIIT France a-t-il choisi comme thématique annuelle pour ses activités 2008-2009 : « Spiritualité et éthique sociale en islam ». Cette année sera empreinte d’un nouvel essor où la spiritualité sera reconsidérée dans son implication et sa finalité sociétales.
IIIT France consacre son deuxième colloque au thème : « Unité sociale et unicité divine : La place de l’engagement social dans la spiritualité musulmane ». La relation de l’homme à la spiritualité et à son engagement sociétal est perçue comme un tout indissociable. Les échanges, au cours de ce colloque, nous permettront de mieux appréhender les enseignements et les repères nécessaires pour atteindre cet équilibre tant recherché : celui de l’homme dans sa relation à Dieu, à lui-même et à l’autre. La question de la spiritualité et ses implications sociales est aussi une question de citoyenneté et de
responsabilité dans le vivre ensemble. Alors, quelle place pour la spiritualité dans nos sociétés modernes et quels apports peut-elle nous offrir pour conjuguer la paix de l’âme et la paix entre les hommes?
Ce colloque rend hommage aux Dr Mona Abul-Fadl et Dr Abdelwahab Elmessiri, deux éminents penseurs du monde arabo-musulman qui nous ont quittés l’été dernier. Chacun d’eux, à partir de son domaine d’études, s’est fait connaître pour ses idées unificatrices de la nation de l’islam, à partir des sources unificatrices de la spiritualité. Mona
Abul-Fadl, docteur en sciences politiques, a fondé l’ensemble de son oeuvre sur l’unification des sciences islamiques et des sciences sociales, afin d’édifier une nouvelle approche civilisationnelle des sciences politiques et inviter la Oumma musulmane à s’unir et devenir charismatique. Abdelwahab Elmessiri, quant à lui, spécialiste de la littérature anglaise, a traité notamment divers sujets allant du sionisme au postmodernisme en passant par la pensée politique musulmane, les mouvements de libération de la Palestine et l’intifada. Il a défendu l’idée selon laquelle, nulle victoire sans unité sociale. Ainsi, a t-il appelé, tout au long de sa vie, à l’unité de la nation musulmane contre les agressions dont elle est victime. Ces deux grands penseurs se rejoignent sur l’importance de l’unité de la foi dans l’unité sociale, de la spiritualité comme fondement pour toute éthique sociale.
Entrée Libre
Institut international de la pensée islamique (IIIT France)
9-11, avenue Michelet 93400 Saint Ouen
Tél : 0140102446 Fax : 0140102447
E-mail : iiitfrance@yahoo.fr
www.iiitfrance.net
 La construction d’une identité européenne, un souci partagé
La construction d’une identité européenne, un souci partagé Rovereto mai 2008
Ahmed Jaballah, directeur de l’Institut européen des sciences humaines de Paris, vice-président de la Fédération des organisations islamiques d’Europe (F.O.I.E), membre du conseil d’administration de la CMRP France
L’identité européenne, une identité en construction
Il est certain que l’identité européenne, en tant que valeurs partagées, est constituée d’éléments philosophiques et culturels différents, qui reviennent à des racines historiques et s’alimentent continuellement d’éléments nouveaux. C’est une identité, comme toute identité collective, qui essaie de conjuguer l’unité et la diversité. Les valeurs de cette identité sont souvent exprimées à travers un certains nombre d’objectifs et de principes, qui sont : la paix, la prospérité, la démocratie, la liberté, l’égalité, la justice, les droits de l’homme, la cohésion sociale, la protection de l’environnement, le dialogue interculturel… Une identité collective permet à toute société humaine de fonder une cohésion nécessaire à un vivre ensemble dans la solidarité et l’entraide, sans nier le besoin de la diversité entre ses membres. Toutes ces valeurs évoquées sont dans leur globalité des valeurs universelles vers lesquelles aspire toute l’humanité, au-delà de ses différences ; et l’Europe tend, à travers sa démarche d’union, de transformer en réalité ces valeurs ambitieuses dans la vie de ses peuples. C’est un défi considérable à relever, d’où la nécessité de mettre en contribution toutes les forces et les ressources pour construire une identité européenne humaine forte et ouverte.
La contribution des religions dans la construction de l’identité européenne :
Les religions ont certainement un rôle à jouer dans cette belle aventure de la construction d’une identité européenne, au moins pour deux raisons essentielles :
- Toutes les valeurs qui peuvent être à la base de l’identité de l’Europe sont des valeurs prônées dans leur ensemble par les religions ; certes exprimées selon des approches différentes, mais qui peuvent être enrichissantes et complémentaires.
- La capacité spirituelle des religions représente un facteur important qui peut donner un élan positif à ces valeurs fondatrices de l’identité (1).
Quelle contribution de l’islam dans ce domaine ?
L’islam peut avoir sa contribution dans la fondation de l’identité européenne grâce à deux facteurs importants :
- Une présence large des musulmans dans la majorité des pays européens, qui fait de l’islam la deuxième religion dans certains de ces pays. La foi et la culture religieuse que partagent les musulmans d’Europe entre eux peuvent constituer un élément de rapprochement qui aura ses répercussions sur les rapprochements des peuples européens (2).
- La dimension historique d'une expérience musulmane qui a pu conjuguer à la fois l’unité et la diversité, y compris en Europe dans la période andalouse, et dans les pays de l’Europe de l’Est. Une expérience qui a eu ses difficultés mais aussi ses apports positifs.
Quelles sont alors les responsabilités partagées pour construire une identité européenne ?
Les musulmans d’Europe ont une responsabilité dans la construction d’une identité européenne. Une responsabilité qui ne peut apporter ses fruits qu’avec une volonté des sociétés européennes, cherchant à mettre en harmonie toutes les compétences et les énergies diverses, au service d’un destin commun. La responsabilité des musulmans contribuant à l’identité européenne prend ses fondements essentiellement dans trois engagements qui sont déjà entrepris :
- Un engagement visant à intégrer progressivement leur tradition et leur expression religieuses dans le contexte européen. Témoignent de cet engagement toutes les initiatives prises dans la construction des lieux de culte en parfaite insertion dans le paysage urbain de nos villes, dans la formation des imams et des cadres religieux, dans l’acquisition de cimetières et de carrés musulmans pour enterrer les morts…
- Un engagement citoyen qui amène le citoyen européen de confession musulmane à prendre part à la vie de la société, à travers ses activités sociales, culturelles et politiques. Un engagement qui a besoin d’être renforcé et encouragé.
- Un engagement dans le dialogue interculturel et interreligieux qui connaît une évolution constatée. De plus en d’initiatives sont entreprises dans ce domaine, et le nombre croissant d’associations de dialogue à l’échelle locale, nationale et internationale auxquelles participent des musulmans en est un témoin. En parallèle à cette responsabilité des musulmans, il y a certainement une responsabilité de la société, qui peut permettre à la contribution musulmane d’apporter sa pierre à l’édifice de l’identité européenne. La responsabilité de la société dans ce domaine, corespond à une revendication citoyenne de a part de la composante musulmane européenne, mettant en avant aujourd’hui les exigences suivantes :
- Une confiance accordée aux citoyens musulmans en tant qu’acteurs positifs, qui ont leur place entière dans la société. Une telle confiance renforce l’engagement, dissipe les facteurs de repli et de marginalisation et fait exploser les énergies servant l’intérêt commun.
- Un combat rigoureux de toutes les formes de racisme, de xénophobie et d’islamophobie. Les différences et les spécificités de chaque communauté religieuse et culturelle peuvent constituer un élément d’enrichissement mutuel, comme elles peuvent être des facteurs d’isolement, en fonction de l’approche suivie dans le traitement de ces différences et de ces spécificités.
- Une gestion désintéressée de la question religieuse musulmane en Europe, et notamment au niveau de la représentation cultuelle des musulmans. La tradition européenne, très marquée par le sécularisme dans le rapport entre l’Etat et la religion, doit être respectée en ce qui concerne les musulmans. Tant que les musulmans agissent dans le cadre des lois, ils doivent être libres et indépendants pour s’organiser, former leurs cadres religieux et construire leur expression religieuse fidèle à leur tradition. Toute ingérence politique intérieure ou extérieure ne peut que trahir les principes d’égalité juridique entre les différentes confessions. Le traitement politique de certains pays européens voulant lier les affaires religieuses des musulmans d’Europe avec des pays musulmans étrangers laisse apparaître l’islam comme une religion étrangère, qui n’a pas le droit de cité comme toutes les autres religions présentes en Europe. La présence musulmane en Europe est une chance permettant de construire une identité européenne riche d’un patrimoine culturel et religieux diversifié, ce qui donne à cette identité une dimension planétaire.
En effet, l’identité d’une Europe unie et juste est une belle entreprise qui a besoin de toutes les forces vives. A l’ère d’une mondialisation globalisante et envahissante qui caractérise notre époque, nous devons confirmer des repères qui donnent à l’Homme l’espoir et lui garantissent la paix et la solidarité. Nous avons besoin certes de partir des acquis de l’Histoire, mais surtout d’insister sur le présent tout en en se projetant dans l’avenir; comme l’a bien exprimé Edgar Morin en disant de la communauté européenne :
« Notre communauté de destin n’émerge pas de notre passé qui la contredit, elle émerge à peine de notre présent parce que c’est notre futur qui nous l’impose (3) »
Ahmed Jaballah
(1) Jacques Delors disait dans l’un de ses discours en 1989 : « Il nous incombe… de donner plus de chair à cette communauté, et pourquoi pas un supplément d’âme. »
(2) Nous pouvons constater cette réalité de rapprochement et d’échange entre les musulmans d’Europe lors de leurs rencontres où ils expriment à la fois une unité de foi et une diversité de cultures qui leur permet de découvrir les richesses des langues et des cultures européennes.
(3) Edgar Morin, Penser l'Europe, Ed. Gallimard, 1987.


